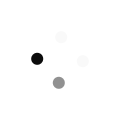Vous avez ouvert sept écoles de cuisine gratuites pour redonner une seconde chance aux jeunes éloignés de l’emploi. Comment est née cette idée ? L’histoire de Cuisine mode d’emploi(s) est assez simple. En 2004, j’ai bénéficié d’un reportage dans Envoyé spécial qui racontait mon parcours et les difficultés que rencontraient les personnes d’extraction sociale modeste, issues des quartiers. Énormément de gens m’ont écrit. Mais pour une personne qui sort de la cage d’escalier, il y en a 1000 ou 10 000 autres qui n’ont pas l’opportunité d’en sortir. Je voulais faire quelque chose. Je suis allé voir le Secours populaire français, puis les Restos du cœur. J’ai rencontré Véronique Colucci et nous avons fait un livre de cuisine ensemble. On s’est aperçu qu’il servait pour apprendre la cuisine quand on a un budget assez modeste, mais aussi comme support pour apprendre la langue française. Je me suis dit que je tenais un truc pour la formation professionnelle dans les quartiers. J’ai repris le cadre qui m’a servi à moi : « Faire pour apprendre ». Dans ma scolarité, au collège, j’avais beaucoup de mal à « apprendre pour faire ».
Comment ces écoles fonctionnent-elles ? Nous allons à l’essentiel : 80 gestes de base, 90 recettes du patrimoine culinaire français. Après 12 semaines, vous arrivez au statut de commis de cuisine. Ça a marché : on a 95 % de retour à l’emploi. Sur 1 500 personnes formées en Île-de- France, 11 personnes ont créé leur entreprise, alors qu’avant elles étaient en situation de précarité. Ces personnes qu’on avait considérées hors des écrans radar, qu’on avait assignées à l’échec, on s’aperçoit qu’il y a une véritable dynamique quand le cadre est posé. Notre cadre, c’est un : le passé des personnes ne nous intéresse pas. Deux : nous avons une règle qui est simple, RER, rigueur, engagement et régularité.
Les élèves doivent venir tous les jours et ne pas être en retard, c’est la monnaie d’échange pour bénéficier de cette école gratuite.
Est-ce votre parcours personnel qui vous a sensibilisé à l’importance de la formation ? Ce qui m’a sauvé, c’est le « faire pour apprendre ». Quand j’étais chez les Compagnons du devoir, les anciens m’ont dit : « On est une entreprise, il faut produire. On verra plus tard pour la scolarité, on va d’abord te confier une mission. » Ma mission quand j’étais jeune apprenti, c’était de faire de la crème pâtissière, puis de la pâte à choux. Puis un jour, on m’a demandé de diviser les recettes, car il y avait moins de clients. Ça piquait un peu les yeux ! Un ancien m’a dit : « C’est pas compliqué, on va le faire ensemble… » Au fur et à mesure, je suis passé de « comment je devais apprendre » à « pourquoi ». Ces formations donnent du sens, encore plus aujourd’hui avec l’outil numérique.
L’enseignement agricole est parfois considéré comme une voie de garage. Comment changer le regard de la société sur la formation professionnelle ? C’est très simple, ça vient de la branche. Les acteurs doivent s’asseoir autour d’une table, se dire : « Qu’est-ce que j’attends d’un jeune ouvrier agricole, comment je vais l’aider à s’épanouir ? » Il faut prendre la base, regarder ce qu’il est absolument nécessaire de connaître, là aussi « faire pour apprendre ». À la branche de redéfinir un cahier des charges beaucoup plus précis. L’accès à la formation professionnelle doit être beaucoup plus rapide et simplifié.
L’attractivité du métier rentre aussi en ligne de compte… Dans le quartier où je suis né, les jeunes n’ont pas accès à l’agriculture. Ils ne la connaissent même pas. Ils ne savent pas ce qu’est une vache. Pour eux, le lait est en brique dans un supermarché. Ça veut aussi dire que le monde de l’agriculture ne s’intéresse pas aux possibilités qu’il y a dans ces quartiers. Et surtout, comme dans ma branche, on ne sait pas mettre en valeur ce que va être le métier. Quelqu’un qui rentre dans une filière, il faut pouvoir lui demander où il se voit dans deux ans et lui dire comment on va l’aider à s’épanouir. On a besoin de cette projection pour se dire : « Ce métier est totalement épanouissant. » La formation professionnelle est faite pour faire des hommes libres. Quand on appuie sur ce bouton, cela vous oblige à réfléchir dans toutes les directions. Quelle agriculture voulons-nous pour demain ? Avec quel type d’entreprises agricoles ?
Vous travaillez justement avec le Centre français d’innovation culinaire (CFIC) sur l’avenir de notre alimentation… D’ici 2050, il faudra nourrir plus d’individus. J’entends ça. Mais avec la même quantité d’eau, ça va poser problème. Je pense que notre alimentation, ce sera 80 % de protéines végétales et 20 % de protéines animales. C’est ce que je fais dans mes restaurants. Ça a du sens pour demain, parce que, là, on va pouvoir nourrir plus d’individus sur cette planète.
Ça veut dire moins d’éleveurs ? Non, je suis sûr qu’on aura quasiment autant d’éleveurs. Ceux qui doivent partir partiront, ceux qui ont envie de faire de la qualité resteront. Moi, je cherche de la salers tout le temps. Je cherche de la blonde d’Aquitaine de qualité tout le temps, de la limousine tout le temps. Il y a à peine vingt ans, il fallait sept ans pour faire un bœuf de Bazas. Aujourd’hui, en quatre ans, c’est plié. Je préfère attendre un peu plus, avoir une viande de meilleure qualité et je suis prêt à la payer plus cher. Les éleveurs, au lieu de faire 200 têtes, ils en feront peut-être 60. Mais on aura une meilleure qualité. C’est pour ça que je pense qu’il y aura pas de pertes d’agriculteurs.
Continuer la lecture...