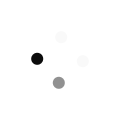Depuis quand pratiquez-vous l’Agriculture de conservation des sols (ACS) ? J’étais jeune installé lors de la réforme de la Pac en 1992. Avec mon associé, on a commencé à se poser des questions sur la réduction des coûts et du temps de travail. Il y avait aussi l’aspect charges de mécanisation qui nous faisait réfléchir. Ça a vrai-ment été une façon différente de voir notre métier. Concernant l’ACS, il y avait plusieurs ingénieurs agronomes qui commençaient à faire du « bruit » autour de cette technique. On est allé à la rencontre de précurseurs, comme les Bourguignon, Frédéric Thomas et Konrad Schreiber. Ça nous paraissait cohérent avec notre philosophie : lier l’acte de production à la réduction de notre impact sur le milieu. En 1997, on a vendu la charrue. Nous avons mis la technique au service de l’Homme, alors que notre génération a fait l’inverse.
Depuis quand pratiquez-vous l’Agriculture de conservation des sols (ACS) ? J’étais jeune installé lors de la réforme de la Pac en 1992. Avec mon associé, on a commencé à se poser des questions sur la réduction des coûts et du temps de travail. Il y avait aussi l’aspect charges de mécanisation qui nous faisait réfléchir. Ça a vrai-ment été une façon différente de voir notre métier. Concernant l’ACS, il y avait plusieurs ingénieurs agronomes qui commençaient à faire du « bruit » autour de cette technique. On est allé à la rencontre de précurseurs, comme les Bourguignon, Frédéric Thomas et Konrad Schreiber. Ça nous paraissait cohérent avec notre philosophie : lier l’acte de production à la réduction de notre impact sur le milieu. En 1997, on a vendu la charrue. Nous avons mis la technique au service de l’Homme, alors que notre génération a fait l’inverse.
Vingt ans plus tard, quel recul prenez-vous sur votre passage en ACS ? Il nous a fallu du temps pour comprendre que l’ACS n’était pas uniquement une nouvelle technique, mais un bouleversement complet de système. Les conseillers en tout genre nous disaient que notre manière de travailler était ridicule. Heureusement, on avait une solidité économique qui nous a permis de faire des erreurs. Par exemple, sur le maïs, on a eu beaucoup de mal les dix premières années. On a fini par comprendre qu’il fallait complètement supprimer le travail du sol, même léger. C’est parce qu’on a été confrontés à ces échecs et que l’on a appris de nos erreurs que nous pouvons maintenant partager notre expérience au sein de l’Apad (Association pour la promotion d’une agriculture durable).
À quel moment avez-vous intégré l’Apad ? J’ai rejoint cette association en 2010, lors de la création de l’Apad Centre-Atlantique. De son côté, la structure nationale avait été créée en 1996. À l’époque, l’association était précurseure en ACS. Elle a aidé a créer le réseau Base (Biodiversité, agriculture, sol et environnement, NDLR) et le magazine TCS. Elle est ensuite entrée en sommeil quelques années, avant de reprendre son développement il y a dix ans sous l’impulsion d’une dizaine d’agriculteurs. Benoît Lavier, mon prédécesseur à la présidence de l’Apad, a été la cheville ouvrière de ce renouveau. Aujourd’hui, elle regroupe dix associations régionales indépendantes et plus de 1 000 agriculteurs.
Quel est le rôle de l’Apad ? Nous nous donnons deux missions principales : être un lieu de rassemblements et d’échanges pour les agriculteurs qui travaillent en ACS et faire reconnaître cette agriculture par les pouvoirs publics. Les associations régionales organisent une multitude d’événements. À l’échelle nationale, nous programmons quatre temps forts dans l’année. Notre assemblée générale est le premier d’entre eux. Nous y invitons des experts pour donner une dimension nationale ou internationale au débat. L’Apad est également présente au Salon de l’agriculture. Cette année, 45 agriculteurs se sont succédé durant la semaine pour expliquer leurs pratiques au grand public. Autres temps forts, nos deux journées techniques auxquelles sont invités tous les adhérents. Elles ont lieu dans une région différente chaque année. Enfin, à l’automne, nous organisons les journées Patrimoine sol à l’occasion desquelles nous invitons nos voisins sur nos fermes.
Comment s’annonce l’année 2019 pour l’association ? Nous avons une plateforme d’essai sur le salissement des parcelles en Picardie. On aimerait dupliquer ce type d’essai dans chaque région. Ces projets nous permettent de tester et de mettre en place un référentiel sur l’utilisation par exemple, du glyphosate. Nous travaillons également sur un dossier Réseau rural. L’idée est de fédérer toutes les associations qui travaillent sur l’ACS au sein d’un comité technique national, tout en préservant les individualités de chacun. Nous poursuivons également notre pro-jet Dycasol. Son principe : faire des analyses de sol sur la matière organique chez tous nos adhérents du Grand Ouest pour faire un bilan de l’évolution au bout de cinq ans. On vise une sur-face de 20 000 ha analysés.
Comment vivez-vous le débat actuel concer-nant le glyphosate ? On est en train de pourrir la totalité de l’approche politique sur les phytos avec des questions mal placées. Le problème, c’est la remise en cause aussi caricaturale que rapide du glyphosate. Notre manière de cultiver nous a permis de diminuer largement l’utilisation de fongicides et d’insecticides. Mais dire aujourd’hui que l’agriculture pourra se passer complètement d’herbicide sans labourer, c’est faux. J’aimerais aussi que le gouvernement soit un peu plus clair sur les modalités d’utilisation par les agriculteurs en ACS. De notre côté, nous souhaitons identifier les exploitations agricoles où l’agriculture de conservation des sols est vrai-ment pratiquée. On va travailler sur ce point avec le ministère.
Quel développement entrevoyez-vous pour l’ACS ? C’est la troisième voie qu’emprunteront les agriculteurs demain ou après-demain. C’est un message que je veux faire passer aux JA : il faut vraiment que la compréhension du sol soit remise au centre de notre métier. Maintenant, nous surveillons l’utilisation qui peut être faite de cette forme d’agriculture. On peut imaginer une valorisation pour les services environnementaux rendus par l’ACS. Il faut que les agriculteurs s’emparent les premiers de la valeur ajoutée qui va se dégager de ce changement de système. On voit qu’il y a déjà beaucoup d’acteurs économiques qui s’y intéressent. Pourquoi pas, mais le monde agricole doit garder la main. À titre personnel, j’ai été invité au comité stratégique de Carrefour par Alexandre Bompard (PDG de Car-refour, NDLR) pour voir comment on pouvait expérimenter ces idées-là.
Continuer la lecture...